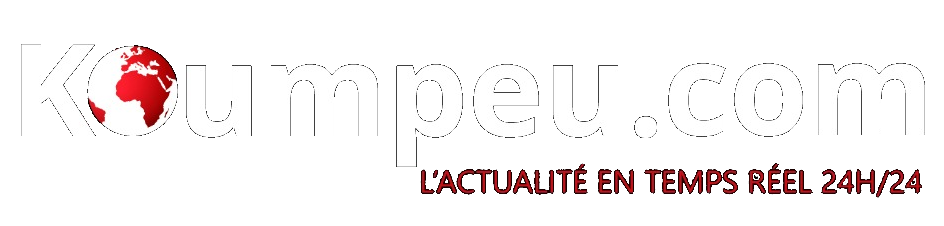Malgré les pressions israéliennes, Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France allait reconnaître l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre à New York. France 24 retrace l’histoire qui a empêché cet État de voir le jour.
De l’Empire ottoman au mandat britannique
1916 – Conclus en mai entre la France et le Royaume-Uni, les accords Sykes-Picot délimitent les futures sphères d’influence des deux puissances dans les territoires du Moyen-Orient, comme la Palestine ou la Syrie, qui font alors partie d’un Empire ottoman vacillant.
1917 – La déclaration Balfour, du nom du ministre britannique des Affaires étrangères Arthur Balfour, promet, en pleine Première Guerre mondiale, « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif ». Avant de répondre favorablement aux aspirations sionistes, Londres avait promis, au chérif Hussein de La Mecque, la création d’un royaume arabe indépendant sur les décombres de l’Empire ottoman.
1922 – La Société des Nations (SDN), ancêtre de l’Organisation des Nations unies (ONU), accorde au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Dans son communiqué, la SDN reprend les termes de la déclaration Balfour sur « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif ». Elle précise que « l’administration de la Palestine assumera la responsabilité d’édicter une loi sur la nationalité [qui] comportera des clauses destinées à faciliter aux juifs qui s’établiront en Palestine d’une façon permanente l’acquisition de la nationalité palestinienne ».
1937 – Après le début des émeutes arabes, en 1936, contre le mandat et l’immigration juive, un rapport de la commission britannique Peel recommande la partition de la Palestine en un État juif comprenant 33 % du territoire et un État arabe rattaché à la Transjordanie.
Un « État juif » et un « État arabe »
1947 – En février, le Royaume-Uni, qui souhaite renoncer à son rôle de mandataire, soumet la question de la Palestine à l’ONU. En novembre, l’Assemblée générale des Nations unies adopte, malgré l’opposition unanime des délégations arabes, la résolution 181 qui appelle à partager la Palestine en un « État juif » et un « État arabe », Jérusalem, se voyant placée sous contrôle international.
1948 – À l’expiration du mandat britannique sur la Palestine, David Ben Gourion, alors président du Conseil national juif, proclame l’indépendance de l’État d’Israël le 14 mai. La création de l’État hébreu, qui prend alors le contrôle de 77 % du territoire de la Palestine sous mandat, selon l’ONU, est synonyme de Nakba (« catastrophe » en arabe) pour les Palestiniens, chassés de leurs terres et condamnés à un exode forcé. À ce jour 4,1 millions de Palestiniens sont enregistrés auprès de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).
1949 – Un cessez-le-feu met un terme à la première guerre israélo-arabe et attribue à la Jordanie le contrôle de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, tandis que la bande de Gaza passe sous administration égyptienne. Les lignes de cessez-le-feu deviennent, quant à elles, les frontières d’Israël – plus favorables que celles du partage de l’ONU.
La même année, l’’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 273, qui admet Israël comme membre de l’ONU. L’année suivante, Israël transfère sa capitale de Tel-Aviv à la partie occidentale de Jérusalem.
Carte du Proche-Orient après la première guerre israélo-arabe (1948-1949).
Le Proche-Orient après la première guerre israélo-arabe (1948-1949). © France 24
1964 – L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) est fondée au Caire. Elle est habilitée à négocier et conclure des traités internationaux au nom des Palestiniens.
La guerre des Six-Jours redessine les frontières
1967 : la troisième guerre israélo-arabe, ou guerre des Six-Jours, est déclenchée par Israël, qui, entre le 5 et le 10 juin, met en déroute les armées des pays arabes voisins et refaçonne la carte du Proche-Orient. L’État hébreu s’empare de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï et du plateau du Golan. Le gouvernement israélien met en place une politique de colonisation des nouveaux territoires conquis.
Carte des territoires occupés par Israël après la guerre des Six-Jours, en 1967.
Territoires occupés par Israël après la guerre des Six-Jours, en 1967. © Studio graphique France Médias Monde
1974 – L’Assemblée générale de l’ONU reconnaît le droit des Palestiniens à l’autodétermination et à l’indépendance et accorde un statut d’observateur à l’OLP.
1987 – La première intifada (« soulèvement » en arabe) débute dans la bande de Gaza et s’étend rapidement à la Cisjordanie. Surnommée la « guerre des pierres », cette révolte contre l’occupation israélienne dure jusqu’en 1993 et replace la cause palestinienne au centre de l’agenda international. C’est aussi durant ce soulèvement que naît le mouvement islamiste Hamas, qui prône la destruction de l’État d’Israël.
1988 – Réunie à Alger, l’Assemblée législative de l’OLP proclame un État palestinien indépendant dont la capitale sera Jérusalem-Est, et reconnait implicitement l’existence d’Israël.
Après les accords d’Oslo, la perspective d’un État palestinien ?
1993 – Le chef de l’OLP Yasser Arafat et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin signent à Washington la Déclaration de principe sur l’autonomie palestinienne négociée en secret en Norvège, communément appelée « accords d’Oslo ». Ces derniers devaient poser les jalons pour régler le conflit israélo-palestinien et établir les bases d’une autonomie palestinienne à l’intérieur des frontières de 1967.
Le premier volet crée, en 1993, l’Autorité palestinienne, une entité intérimaire supposée s’effacer en 1999 avec la perspective de création d’un État indépendant.
1995 – Les accords d’Oslo II divisent la Cisjordanie en trois zones : la zone A contrôlée par les Palestiniens, la zone B au contrôle partagé, et la zone C, représentant plus de 60 % du territoire, qui devait progressivement passer aux mains des Palestiniens mais reste entièrement contrôlée par l’armée israélienne.
En revanche, les questions les plus sensibles des frontières, du statut de Jérusalem, des colonies israéliennes et du droit au retour des réfugiés palestiniens restent en suspens.
1996 – Organisation des premières élections palestiniennes, Yasser Arafat élu à la tête de l’Autorité palestinienne.
1998 – Bill Clinton est le premier président américain reçu en visite officielle par un État palestinien virtuel.
Luttes de pouvoir inter-palestiniennes
2000 – La seconde intifada, également appelée « Intifada al-Aqsa », éclate au lendemain de la visite du chef du parti de droite israélien Likoud, Ariel Sharon, sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.
2002 – L’Initiative arabe, adoptée en 2002 et relancée en 2007, prévoit notamment une normalisation des relations entre les pays arabes et Israël en échange du retrait israélien des territoires arabes occupés depuis juin 1967 et la création d’un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. La même année, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1397, confirmant son attachement à la solution à deux États.
2005 – Mahmoud Abbas est élu président de l’Autorité palestinienne. Après trente-huit années d’occupation, Israël se retire de la bande de Gaza.
2007 – Le Hamas, vainqueur des législatives de 2006, prend par la force le contrôle de la bande de Gaza, le leadership palestinien se fracture.
Une quête de reconnaissance portée devant les instances internationales
2011 – Le président palestinien, Mahmoud Abbas, présente la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations unies. La même année, la Palestine devient membre à part entière de l’Unesco. En réaction, les États-Unis, alliés indéfectibles d’Israël, suspendent leurs subventions à l’organisation onusienne (22 % de son budget global).
2012 – L’ONU reconnaît la Palestine comme « État observateur non membre » (138 voix pour, 9 contre et 41 abstentions).
2015 – Confronté à un Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a promis à plusieurs reprises qu’un État palestinien ne verrait jamais le jour tant qu’il serait au pouvoir, l’Autorité palestinienne poursuit ses démarches à l’ONU et dans d’autres organisations (adhésion à la Cour pénale internationale).
2016 – Le Conseil de sécurité adopte la résolution 2334, qui enjoint Israël de « cesser immédiatement et complètement toutes activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », soulignant qu’il ne reconnaîtra « aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations ».
2017 – L’administration Trump annonce que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale d’Israël et demande au département d’État d’y déplacer l’ambassade américaine en Israël.
2019 – La Maison Blanche dévoile le plan économique de Donald Trump pour les Palestiniens, censé « transformer la Cisjordanie et Gaza de manière fondamentale », mais sans que le texte n’évoque l’idée de la création d’un État palestinien.
La carte de « l’accord du siècle » de Donald Trump pour Israël et un futur État de Palestine.
La carte de « l’accord du siècle » de Donald Trump pour Israël et un futur État de Palestine. © DR
2020 – Donald Trump indique que la création d’un État palestinien serait possible à condition que les Palestiniens se plient aux conditions prévues dans son plan de paix. Il propose que cet État palestinien soit constitué « d’un seul tenant », les différentes parties seraient alors reliées par « des réseaux de transport modernes et efficaces » et des tunnels. Le président américain a évoqué la création d’une capitale palestinienne dans « Eastern Jerusalem », ce qui peut désigner Jérusalem-Est.
7-Octobre, guerre à Gaza… l’exigence d’un État palestinien relancée ?
2023 – L’attaque du Hamas et de ses alliés sur le territoire israélien, le 7 octobre, et la riposte israélienne dans la bande de Gaza, replacent le conflit israélo-palestinien au centre de l’actualité internationale. La question de la solution à deux États, fragilisée à la fois par la politique de Benjamin Netanyahu, un Mahmoud Abbas largement déconsidéré, la montée en puissance du Hamas à Gaza, et la colonisation de la Cisjordanie, est de nouveau sur la table.
2024 – L’Assemblée générale vote à une écrasante majorité pour l’admission de l’État de Palestine à l’ONU et rehausse son statut d’Observateur permanent. Alors que trois pays européens, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège, ont officiellement reconnu l’État de Palestine, la France, par la voix du président Emmanuel Macron, se dit « prête à reconnaître » un tel État.
De son côté, le gouvernement israélien, le plus à droite de l’Histoire, annonce la saisie de la plus grande parcelle de terre en Cisjordanie occupée depuis les accords de paix d’Oslo en vue d’y bâtir de nouvelles colonies.
2025 – La France s’engage officiellement en faveur de la reconnaissance imminente de l’État palestinien, Emmanuel Macron affirmant qu’il ne s’agissait « pas simplement d’un devoir moral, mais d’une exigence politique ».
Le président français devait franchir le pas lors de la Conférence sur la solution dite à deux États du 17 au 21 juin à l’ONU. Mais celle-ci a été reportée après l’attaque israélienne sur l’Iran.
Le 10 juillet, en visite officielle au Royaume-uni, Emmanuel Macron a appelé à une reconnaissance commune de l’État de Palestine par Paris et Londres.
Le 24 juillet, Emmanuel Macron annonce que la France va reconnaître l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre à New York.