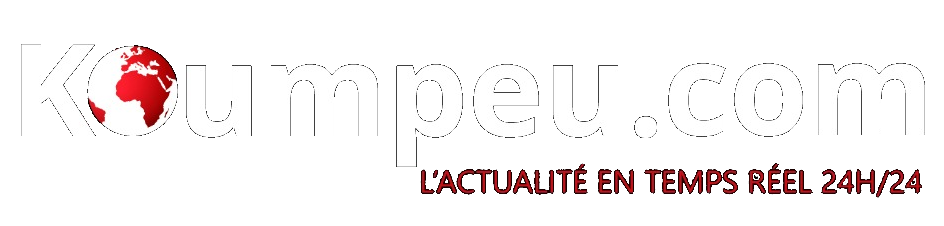Il y a cent ans, le 2 juillet 1925, naissait dans le village d’Onalua, en République démocratique du Congo (RDC), celui qui allait devenir l’une des grandes figures de l’histoire africaine du XXe siècle et l’un des espoirs volés du continent : Patrice Lumumba. Devenu Premier ministre après la victoire de son parti, le MNC, en 1960, il est arrêté par Mobutu le 1er décembre de cette année, livré aux autorités sécessionnistes du Katanga et assassiné le 17 janvier 1961. Il devient, après sa mort, un symbole aux dimensions planétaires. Retour sur l’histoire d’un phénomène qui, parti d’une vague de colère, a mobilisé tous les arts et traversé les continents.

13 février 1961. Elisabethville. 15h00. Le ministre de l’Intérieur katangais, Godefroid Munongo, a convoqué une nouvelle conférence de presse sur Patrice Lumumba. L’atmosphère est tendue. Trois jours plus tôt, il a prétendu devant les mêmes journalistes internationaux que Patrice Lumumba (le Premier ministre déchu), Maurice M’Polo (l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports) et Joseph Okito (l’ancien président du Sénat) s’étaient « échappés cette nuit de la ferme où ils étaient détenus, après avoir assommé deux de leurs sentinelles ». Cette fois-ci, il déclare solennellement que Patrice Lumumba, Okito et Mpolo ont été « massacrés » par les habitants d’un petit village. Les corps, soutient-il, ont déjà été enterrés dans un endroit qui ne sera pas révélé, pas plus que le nom du village où les trois hommes auraient été massacrés. Puis Munongo a cette phrase glaciale, cynique : « Je mentirais si je disais que le décès de Lumumba m’attriste. » Tout cela n’est que mensonge et diversion : le pouvoir katangais a, de fait, exécuté les trois hommes, à l’issue d’un scénario dans lequel on retrouve également la CIA américaine et le pouvoir belge.

La presse doute, elle est sceptique, mais la nouvelle est partagée par les correspondants présents, parfois avec réserve. Elle est démultipliée par les agences de presse, arrive sur les téléscripteurs des rédactions du monde entier, est propagée par les médias. Elle provoque une émotion planétaire.
L’URSS prend immédiatement la tête du mouvement international de dénonciation. Dès le lendemain de l’officialisation de la mort, le 14 février, le gouvernement soviétique publie une déclaration officielle particulièrement virulente. Le président ghanéen, Kwame Nkrumah, prononce, lui, trois discours à quelques jours d’intervalle : à la radio dès le 14 février 1961, lors de commémorations officielles le 15, puis lors de la pose de la première pierre de l’Institut d’études idéologiques de Winneba le 18 février, en présence de Léonid Brejnev, président du présidium du Soviet suprême. Ce dernier discours est le plus fort : Nkrumah y soutient avec des détails précis la thèse de l’exécution. Il indique qu’un officier belge a ordonné à un soldat africain de tirer sur M’Polo, Okito et Lumumba. Le soldat, explique-t-il, abaisse son fusil quand vient le tour de Patrice Lumumba et c’est l’officier belge qui dégaine alors son revolver pour tuer le Premier ministre déchu. Kwame Nkrumah voit dans cet assassinat les raisons d’un sursaut politique africain : « Je n’ai jamais cessé de crier à toute l’Afrique [la nécessité de] l’unité africaine. Le triste épisode au Congo fait plus que justifier mes craintes ; [il dit] l’imprudence de rester seul, chacun par soi-même, face à cet assaut féroce par les nouveaux colonialistes. »
Une colère mondiale
Des manifestations éclatent en de nombreux endroits de la planète. À Moscou, évidemment, fer de lance du mouvement de colère. Selon le correspondant moscovite du journal singapourien The Straits Times, « Les manifestants ont enfoncé les portes de l’ambassade de Belgique ici hier soir tandis que 6 000 étudiants étrangers et ouvriers moscovites hurlaient des slogans anti-belges pour protester contre la mort de Patrice Lumumba au Congo ». À Varsovie les locaux de l’ambassade de Belgique sont saccagés. À Prague, les manifestants brisent les vitres de l’ambassade de Belgique et accrochent des portraits de Lumumba sur la façade. À Colombo, des centaines d’étudiants manifestent devant la résidence du chargé d’affaires belge. Leurs banderoles proclament : « À bas l’impérialisme ». Des membres du Parti communiste indien se rassemblent à Bombay. Un petit groupe d’étudiants de Lahore, au Pakistan, remet une lettre de protestation au consul général américain. Au Caire, les locaux de l’ambassade de Belgique à Garden-City sont saccagés, les bâtiments incendiés. La colère des manifestants vise aussi les Nations unies, accusées d’être complices.
En Chine, la colère est plus organisée et contrôlée, mais toute aussi impressionnante. Un rassemblement massif a lieu le 20 mars 1961 au stade des Travailleurs de Pékin. Des dizaines de milliers de personnes sont massées là. On parle alors de 100 000 participants à la cérémonie. Le drapeau rouge aux étoiles dorées flotte à mi-mât, symbolisant le deuil national. Le Premier ministre Zhou Enlai prononce un discours d’hommage à Lumumba. Il souligne son rôle crucial dans la lutte pour la dignité et la liberté des peuples africains. Au-delà du stade, le Renmin Ribao (le quotidien du peuple), l’organe officiel du Parti communiste chinois, avance que « Cinq cent mille habitants de la capitale dénoncent l’assassinat de Lumumba par l’impérialisme et affirment leur soutien résolu à la juste lutte du peuple congolais pour la défense de l’indépendance nationale et de l’unité du pays ! »
Sur le continent africain, c’est au Ghana de Kwame Nkrumah que les manifestations sont les plus visibles. Deux jours après l’annonce de la mort de Lumumba, une cérémonie officielle rassemble environ 6 000 personnes. Le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, alors en visite officielle dans le pays, participe à l’hommage. Une procession marche vers le Mémorial de guerre et dépose des couronnes de fleurs, au son de la musique funèbre de tambours. Des manifestants, eux, font exploser leur colère, des banderoles affirment : « Les Belges doivent quitter le Congo. » La foule déchire un drapeau du bureau de l’ONU, et le piétine dans la poussière.
Il y a des manifestations à Bamako, au Mali, où Modibo Keita avait, dès janvier 1961, prédit « la liquidation physique » de Lumumba par « certains milieux occidentaux ». L’émotion est également significative au Sénégal, où le quotidien Paris-Dakar écrit avoir reçu « de nombreux courriers de lecteurs qui fustigent l’assassinat de Lumumba, l’action néocoloniale des anciens colonisateurs dans les pays néo-indépendants et la traîtrise de certains leaders congolais ». L’icône Lumumba est, elle, en cours de construction. Un lecteur, Abdou Diop, écrit : « Lumumba est encore plus grand mort que vivant » et établit un parallèle religieux : « Comme le prophète Jésus, il a été vendu par Kasa-Vubu à Tshombé ».
Quand les artistes façonnent l’icône de Lumumba
Aux explosions de colère succède une dénonciation issue des milieux artistiques ou intellectuels. Dès le 20 février 1961, le psychiatre et philosophe martiniquais Frantz Fanon publie dans Afrique Action un article sur l’assassinat. Il y dénonce les dirigeants africains qui se sont rendus complices de crime. « Le grand succès des ennemis de l’Afrique, écrit Fanon, c’est d’avoir compromis les Africains eux-mêmes. Il est vrai que ces Africains étaient directement intéressés par le meurtre de Lumumba. Chefs de gouvernements fantoches, au sein d’une indépendance fantoche, confrontés jour après jour à une opposition massive de leurs peuples, ils n’ont pas été longs à se convaincre que l’indépendance réelle du Congo les mettrait personnellement en danger. » Il appelle également à soutenir Antoine Gizenga, successeur de Lumumba, et lance : « Gardons-nous de ne jamais l’oublier : c’est notre sort à tous qui se joue au Congo. »
Le poète afro-américain Langston Hughes, figure majeure de la Harlem Renaissance écrit un « poème-sépulture » qu’il intitule « Tombe de Lumumba ». Demain, prophétise-t-il, son épitaphe sera partout. Un autre poète, le Chinois Shimei écrit « Lumengba huozhe » (« Lumumba vivant »), un poème en prose qui est publié dans Le Quotidien du peuple un mois après la mort de Lumumba. Zhang Ke, un autre poète chinois, lance, lui : « Un homme est tombé, des millions se sont levés. »
La musique participe à cette transformation de Lumumba en martyr global de l’anticolonialisme. Le Congolais Franco et son O.K. Jazz enregistrent l’un des tous premiers hommages musicaux, « Liwa Ya Emery ». Le trompettiste nigérian Ogbueshi Eleazar Chukwuwetalu Arinze passe en studio en 1961 pour un « Lumumba Calypso » dans lequel il raconte la vie et l’assassinat de Lumumba tout en célébrant son rôle dans l’indépendance du Congo. Les Ghanéens de The Republicans sortent « Lumumba Deyie », la Zimbabwéenne Dorothy Masuka un « Lumumba », les Nigérians de « Charles Iwegbue & His Archibogs » chantent « Aya Congo Lumumba ». Ailleurs dans le monde, le chanteur cubain engagé Carlos Puebla, compose « Son a Lumumba » en 1961, un morceau qui pointe la responsabilité de l’impérialisme. Le compositeur est-allemand Paul Dessau écrit pour sa part un Requiem für Lumumba (« Requiem pour Lumumba ») qui est créé en 1964 à la salle des congrès de Leipzig.
Le théâtre se saisit aussi de cette histoire tragique et, sur différentes scènes de la planète, la mémoire du sacrifice de Lumumba est perpétuée. En Chine, l’une des œuvres les plus importantes est un drame parlé, intitulé Tam-tams de guerre sur l’équateur (Chidao zhangu). Écrit et produit par une troupe de théâtre de l’Armée populaire de libération, ce drame parlé connaît une première à Pékin en février 1965, puis réalise une tournée dans tout le pays. La pièce raconte ce qu’elle qualifie de lutte anti-impérialiste américaine du peuple congolais, et décrit l’assassinat de Lumumba comme un moment de réveil. Elle est régulièrement mise en scène pour le public national chinois entre 1965 et 1966. Le poète de la négritude, Aimé Césaire, écrit, lui, en 1966 « Une saison au Congo », qui raconte l’accession du pays à l’indépendance et dénonce le néo-colonialisme, notamment au travers de la tutelle des entreprises occidentales. Lumumba est la figure centrale de la pièce. « Les pays coloniaux conquièrent leur indépendance, là est l’épopée », explique Césaire au sujet de ce texte. « L’indépendance conquise, ici commence la tragédie. »
Lumumba est représenté sur des timbres postaux en Égypte, au Ghana, en Guinée. L’URSS produit une iconographie abondante à son sujet entre 1961 et 1962 : une carte postale du peintre soviétique Osenev, qui représente les trois jeunes enfants de Lumumba découvrant des matriochkas sous le regard de leur père, est massivement diffusée. Le peintre Dementii Shmarinov réalise pour sa part en 1961 une œuvre intitulée Le matin de l’Afrique. Patrice Lumumba qui est présentée à l’Exposition artistique de l’Union soviétique et éditée sous forme de carte postale. Lumumba y est dessiné souriant, en martyr vêtu de blanc, ouvrant les bras vers l’avenir d’un continent décolonisé.
L’histoire du Premier ministre est également dessinée sur les toiles et sur les murs. L’artiste italien Renato Guttuso peint en 1961 une œuvre représentant Lumumba en buste, Noble malgré les stigmates de son martyre. Au Congo, Tshibumba Kanda-Matulu jette sur la toile, au début des années 1970, Calvaire d’Afrique qui décrit le transfert de Lumumba à Elisabethville (Lubumbashi) en janvier 1961. Il peint également La mort de Lumumba, où le leader congolais est représenté sur le sol, le sang qui s’écoule de ses blessures formant le mot « unité ». Un artiste de Likasi, Burozi, crée dans les années 1970, Les corps de Lumumba, Mpolo et Okito qui représente les trois corps au cœur de la forêt. Il peint également Lumumba arrivant à Elisabethville qui montre les trois hommes descendant de l’avion. Burozi ajoute trois photographes blancs en costume noir à la scène, illustrant, au travers de la tragédie, comment Lumumba est devenu une icône internationale.
« Aucune forme d’art ne semble échapper à Lumumba », explique Matthias De Groof en introduction de l’ouvrage collectif de référence qu’il a dirigé sur l’iconographie consacrée à Patrice Lumumba, Lumumba in the Arts. « Ce n’est pas un hasard, écrit-il aussi, si une figure historique comme Patrice Lumumba a connu une vie posthume imaginaire dans les arts. Après tout, son projet est resté inachevé et son corps n’a jamais été enterré. »