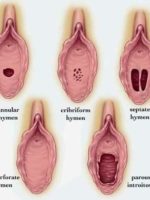koumpeu.com–Depuis notre cachette, on les voit se faire attraper et décapiter devant nous. La mafia qui nous tient fait aussi dans le trafic d’organes. Le témoignage de Tobore Ovuorie fait froid dans le dos. En voulant infiltrer le réseau de trafiquants d’êtres humains du Nigeria, la journaliste ne s’attendait pas à assister à de telles horreurs. «Je pensais que les criminels seraient les mêmes que ceux rencontrés dans la rue. Mais en fait, ceux-là étaient vraiment dégueulasses.»
Tobore Ovuorie est une journaliste primée du site d’enquête nigérian Premium Times. En 2013, elle se déguise en prostituée pour infiltrer un réseau international de trafic de femmes. Une opération dangereuse. La journaliste frôle la mort à plusieurs reprises. Sauvée de justesse, elle publie son histoire au Nigeria en 2014. Il s’agit du premier compte-rendu de source indépendante réalisé depuis l’intérieur du trafic d’êtres humains. La jeune femme mettra plus d’un an à s’en remettre. Elle souffrira d’une dépression nerveuse et suivra un traitement psychiatrique de plusieurs mois.
En octobre dernier, elle a partagé son expérience avec un vaste public en Norvège, où «Le Matin Dimanche» l’a rencontrée. La journaliste semblait alors devoir se faire douleur pour prononcer chaque phrase. «Tout a débuté avec mon amie Ifuoke», commence péniblement Tobore. Sa comparse s’était prostituée pour le compte du syndicat en Europe. Les rapports protégés ne lui étaient alors pas autorisés. «Quand elle a attrapé le sida, le syndicat l’a renvoyée à la maison.
Elle n’a reçu aucun soin médical et en est morte.» Un rapport de l’ONU estime que la moitié des victimes provenant du Nigeria est réexpédiée au pays à cause de maladies. A Abuja, la capitale, Tobore interviewe plusieurs de ces femmes début 2013. «Elles ne souffraient pas seulement du sida, mais aussi de gonorrhée anale, de ruptures d’intestins ou d’incontinence», raconte-t-elle. Beaucoup d’entre elles sont rejetées par leur famille honteuse. «Elles meurent seules et dans des conditions atroces.»
Des officiels impliqués
La journaliste se met alors en tête de se faire passer pour une prostituée afin d’infiltrer le réseau. Fin 2013, elle revêt donc des habits de call-girl et longe les trottoirs d’Abuja. Mais sans passer à l’acte. «Je fixais volontairement des prix trop hauts pour les clients.» Dans la rue, elle entre en contact avec une Mama. «Une grande partie du syndicat se compose de femmes, appelées «Mamas», explique Tobore. Comme de nombreuses autres femmes, elle dit vouloir partir en Europe pour travailler.
Les départs volontaires sont en effet courants. «Certaines savent qu’elles vont se prostituer, mais pas dans quelles conditions, explique Claire Potaux-Vésy, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Berne. On ne leur dit pas qu’elles n’empocheront pas ou que peu de l’argent gagné ou qu’elles devront accepter des rapports non protégés.» Les conditions de vie au Nigeria simplifient la tâche des trafiquants. «Le taux de chômage y est élevé, la pauvreté extrême et les femmes y sont très peu scolarisées, ce qui fait d’elles des cibles faciles à amadouer», commente Anne-Florence Débois, porte-parole de FedPol. Les trafiquants les recrutent via des contacts personnels.
Ils leur font de fausses promesses d’éducation ou de travail en Europe. Bien que volontaires au départ, les femmes perdent rapidement leurs libertés. «On nous appelait «produits» et nous traitait comme telles», affirme Tobore. La journaliste doit poser nue devant un jury. Ce dernier considère que son corps est assez attractif pour être rangé dans la catégorie «force spéciale». Tobore peut ainsi travailler comme escort girl pour de riches clients et éviter le trottoir, à l’inverse de femmes classées dans la «force de rue».
Ce privilège lui permet d’assister à une soirée VIP dans un quartier chic d’Abuja. Là, parmi les clients, elle repère des politiciens. «Ceux-là même qui s’expriment publiquement contre la prostitution et qui font arrêter les femmes dans les rues, déclare Tobore. Ma Mama m’a dit que l’immigration, les douanes, la police, l’armée, et même les ambassades étrangères faisaient partie de leur réseau.» La journaliste voit aussi sa Mama recevoir un grand sac rempli d’argent. De quoi confirmer les thèses policières. «Nos spécialistes supposent que l’argent engrangé en Europe est en grande partie renvoyé au Nigeria, confirme Anne-Florence Débois.
Il est probable que beaucoup de transactions se fassent de la main à la main, ce qui rend très compliqué d’en suivre la trace.» Quelque temps après la soirée, Tobore embarque avec trois femmes d’Afrique de l’Ouest dans un bus, censé les conduire au Bénin, première étape de leur voyage. Mais le convoi s’arrête avant la frontière, dans un camp d’entraînement au milieu de nulle part, entouré par la forêt. Il est gardé par des militaires. Elles y sont accueillies par «Mama C.», la responsable du camp.
Pour Tobore, la suite ressemble «à un film d’horreur». Elle voit Mama C. discuter avec des visiteurs d’un «paquet» qu’elle aurait dû leur délivrer. «L’un d’eux me pointe du doigt mais Mama C. refuse et, pour des raisons inexpliquées, Adesuwa et Omai sont sélectionnées.» C’est à ce moment que Tobore assiste, effrayée, au double meurtre par décapitation, à la machette, de deux de ses comparses. «Le «paquet» se compose en réalité d’une collection de morceaux humains. Ces hommes utilisent des bouts de corps pour faire des rituels.»
En 2004 déjà, un rapport de l’ONU rendait attentif au fait que, au Nigeria, certains organes humains étaient utilisés pour des cérémonies. Pour la première fois, le témoignage de Tobore révèle que les criminels se fournissent aussi auprès des trafiquants de femmes. Après le meurtre, Tobore est conduite dans une salle à part. Mama C. l’interroge: «Qui te protège? D’où viens-tu?» Tobore est frappée et fouettée toute la nuit.
Conduite chez un sorcier
Toujours retenues dans le camps, Tobore et les autres femmes sont conduites chez un sorcier. «Il m’a prélevé des morceaux d’ongles, du sang, des cheveux et des poils pubiens, se souvient la journaliste, et a tout mis dans un paquet qu’il a accroché à un autel.» Elle doit promettre de ne pas trahir le syndicat. Ce rituel d’Afrique de l’Ouest porte un nom: le «juju». «Il s’agissait de la religion commune en Afrique avant la christianisation du continent, explique Stephan Fuchs, consultant pour FedPol sur le Nigeria.
Encore très répandu, le juju a été repris par les trafiquants pour contrôler les femmes.» D’après Anne-Florence Débois, de FedPol, «les victimes croient que les prélèvements faits sur elles peuvent les rendre folles, malades ou les tuer». Pour les polices, les contrats de silence passés avec les sorciers rendent la tâche plus compliquée, puisque les victimes sont souvent paniquées à l’idée de parler.
«La sorcellerie, c’est vrai chez nous, assure Mariame*, une victime sénégalaise accueillie Au Cœur des Grottes à Genève. Ma Mama m’a dit que si je la dénonçais, elle dirigerait des sorts contre moi, ma fille et tous les gens qui m’ont aidée.» Mariame aura besoin de plus d’une année de soutien psychologique à Genève pour ne plus craindre de représailles. «Elle subit une double contrainte.
Elle a peur pour elle, mais aussi pour tous les gens qui lui veulent du bien, constate Marie von Arx-Vernon, directrice adjointe du foyer Au Cœur des Grottes. Il faut des mois, des années pour déconditionner les gens, comme dans une secte.» Marie Von Arx-Vernon estime qu’environ 50% des 180 femmes qu’elle a accueillies en dix-sept ans ont subi des pressions liées à la sorcellerie. Des femmes d’Afrique de l’Ouest, mais aussi du Brésil, d’Indonésie, d’Ethiopie.