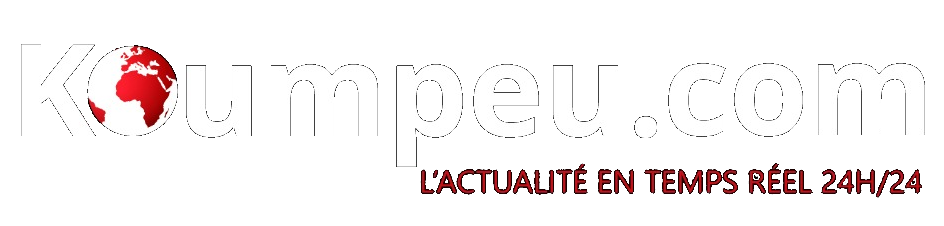À peine installées, les nouvelles autorités sénégalaises font déjà l’objet de critiques sur leur gestion économique, accusées de nourrir l’instabilité budgétaire ou de manquer de lisibilité stratégique. Mais derrière ce procès en précipitation, les chiffres racontent une tout autre histoire : celle d’un héritage lourd, structuré par des déséquilibres profonds.
Fin 2024, la dette publique du Sénégal avoisinait 118 % du PIB, un niveau largement au-dessus des seuils jugés soutenables dans les économies émergentes. Cette détérioration n’est pas uniquement le fruit d’une dynamique d’endettement classique. Elle a été aggravée par la révélation tardive de dettes non déclarées de plusieurs milliards de dollars, entraînant la suspension du programme avec le FMI et une onde de choc sur les marchés internationaux.
Dans ce contexte, la révision en cours de l’année de base du PIB vise un double objectif. Sur le plan technique, il s’agit de mieux refléter la structure économique réelle du pays, en intégrant des pans longtemps sous-évalués comme l’économie numérique, les services ou les industries extractives. Mais sur le plan politique et symbolique, c’est aussi une tentative de corriger un narratif dégradé, hérité d’un pilotage antérieur qui masquait certaines vulnérabilités derrière une façade de stabilité.
Il serait donc réducteur d’analyser cette phase de transition à l’aune des seuls chiffres du présent. Le gouvernement Diomaye-Sonko, en s’attaquant à ces redressements comptables, affronte surtout les limites d’un système de gestion budgétaire devenu opaque et vulnérable. L’enjeu n’est pas simplement de rendre les comptes plus justes, mais de rétablir une chaîne de confiance avec les bailleurs, les marchés et la population.
Ce moment technique est donc aussi profondément politique. Il pose une question centrale : comment exercer une souveraineté économique crédible dans un monde où la notation financière, les ratios macroéconomiques et les récits statistiques façonnent la réputation d’un pays autant que ses fondamentaux réels ? Le gouvernement peut réviser les chiffres, mais il doit surtout bâtir une cohérence budgétaire nouvelle, capable de rompre avec les logiques antérieures sans déclencher de rupture brutale.
La sortie de ce tunnel ne dépendra pas uniquement d’opérations comptables ou de gestes techniques. Elle exigera une pédagogie constante, une transparence accrue et un récit capable de convaincre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Car la vraie stabilité, dans cette nouvelle phase, ne réside pas dans les apparences arithmétiques, mais dans la capacité à articuler rigueur, justice et cohérence stratégique.