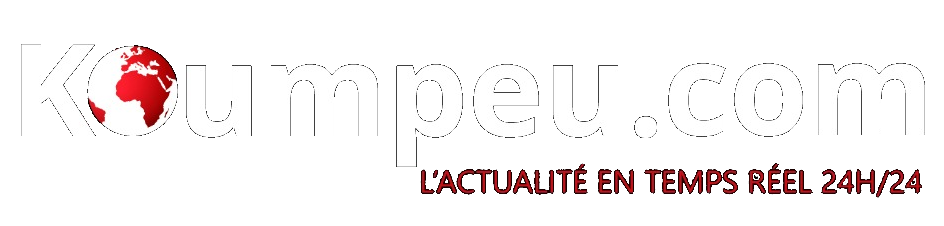Des sorties entre amis, il y en a toujours. Une fois à table avec ceux ci, la conversation bat souvent son plein et l’ambiance est conviviale, mais on ne peut malheureusement pas s’empêcher de jeter, de temps en temps, des coups d’œil sur son téléphone placé juste devant soi. Ce phénomène est appelé le « phubbing ». Le phubbing, mot-valise anglais formé à partir de phone (« téléphone ») et de snubbing (« snober, repousser ») et qui peut se traduire littéralement par « télésnober », est l’acte d’ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone plutôt que de communiquer avec elles.
Surveiller nos réseaux sociaux ou envoyer des SMS alors que des personnes présentes en chair et en os comptent sur notre attention, n’est pas l’attitude la plus respectueuse qui soit. Il suffit juste d’être de l’autre côté de la barrière ou de l’autre table pour mieux le remarquer. Le fait, loin d’arranger les relations amicales, est une dépendance inédite de son appareil téléphonique. Certains, se désolant de ce phénomène, estiment qu’il est préférable de se regarder en face et de profiter du moment présent à deux ou entre amis physiquement, au lieu de toujours le faire virtuellement avec des gens vivant parfois à des kilomètres de soi.
« Je suis peut-être un peu susceptible, mais moi j’ai besoin qu’on me regarde quand je parle. Alors qu’on regarde longuement une fille en mini-jupe passer, un bébé qui pleure, le bruit de klaxon d’un zémidjan (conducteur de taxi moto) cherchant de clients ou que l’on soit concentré sur son téléphone pendant que je parle, c’est pareil finalement. Je veux juste qu’on m’accorde l’attention que je mérite. Je me suis déplacée, je suis présente physiquement, donc je devrais être prioritaire ! », a affirmé avec grand intérêt Natalie Assogba, étudiante en année de licence en communication d’entreprise à Cotonou. Si la jeune refuse d’en tenir le smartphone pour unique responsable, force est de reconnaître l’énorme potentiel de ce dernier pour perturber un moment de sociabilité.
L’un des grands responsables de ce phénomène reste et demeure la réception de notifications qui créée la folle envie de toucher son téléphone.
« On choisit de les installer, mais elles nous rappellent sans cesse à l’ordre. Surtout celles en lien avec l’actu, qui font qu’on est au courant de choses parfois trop rapidement et à des moments que l’on n’a pas choisis », explique Michael, jeune start-up béninoise.
La sociabilité en « danger »
Mais il est aussi courant de voir des personnes consulter leur téléphone sans y avoir été incitées. Un simple réflexe ? Plutôt une pulsion pour Roland qui explique que les accros au smartphone « ont besoin de le consulter fréquemment pour se rassurer ». « Ils ont peur de passer à côté d’une information, d’un message ou d’un like. On appelle ça le “FOMO” : Fear Of Missing Out, littéralement “la peur de manquer quelque chose » », explique Mikael.
Pourtant, en restant connectées virtuellement, ce sont les moments de la vie réelle que les personnes adeptes du phubbing risquent de “manquer”. Selon une étude de Deloitte datant de 2017, 65 % des jeunes, en moyenne, déclarent se servir de leur smartphone pendant les repas en famille ou avec des amis. Parmi ces jeunes, les femmes représentent 75%. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jeunes ne sont pas forcément les premiers. « Les études prouvent que toutes les tranches d’âges et tous les types de personnes sont concernées, car cela révèle souvent une addiction aux écrans, ou au smartphone. Même les personnes âgées en font désormais les frais ».
« C’est ahurissant de constater qu’un couple, décidant de passer un moment ensemble dans un restaurant, passe son temps à rester coller à son téléphone au cours du repas sans profiter pleinement et physiquement de ce moment hors de leur foyer », se désole Sylvie, psychologue clinicienne
Paradoxalement, les personnes qui adoptent ce comportement ne semblent pas le trouver véritablement épanouissant. « Ils s’intéressent moins au moment présent et aux gens qui les entourent. Par exemple, lorsqu’ils mangent avec leur famille ou amis avec le téléphone portable dans la main, ils reconnaissent avoir moins profité du repas et être passés à côté de quelque chose », explique Roland, jeune accro au téléphone portable.
L’art d’éviter des conversations peu intéressantes ?
Alors pourquoi continuer le phubbing ? Peut-être parce qu’à défaut d’y trouver un réel plaisir, certains y trouvent une vraie utilité. Comme celle de reprendre le contrôle sur une situation.
« Ouvrir son téléphone, c’est une façon d’éteindre ce qui se passe en soi, de fermer la page, d’éviter les affects négatifs et autres », décrypte pour nous Sylvie, la psychologue clinicienne. Une porte de sortie bien pratique lorsque l’on fait par exemple face à « quelque chose que l’on ne veut pas entendre » lors d’une conversation. Et la stratégie d’évitement peut être contagieuse, comme l’explique George, 24 ans. L’étudiant en médecine s’est rendu compte que « lorsque quelqu’un se met à regarder son smartphone, il a tendance à en faire de même ». « Comme s’il lui était difficilement supportable de rester à attendre que la personne lui accorde de nouveau son attention. Comme une petite sensation de vide ». C’est dire les sentiments désagréables qui peuvent s’éveiller chez les personnes qui sont mises sur « pause » malgré elles.
Dans des situations pareilles où la tendance semble être une contagion, il est fortement souhaité que « la victime » entame ou ouvre un sujet de discussion afin de créer l’effet contraire. A force de subir, c’est la relation qui est mise à l’épreuve et c’est la manière la plus simple de perdre cette sociabilité légendaire qui caractérise les relations humaines.