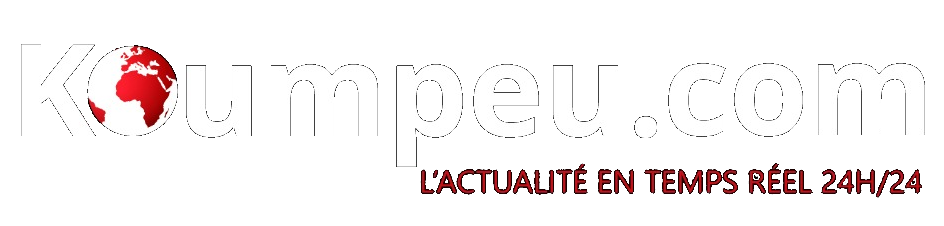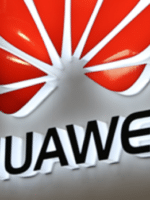Au coeur de la guerre commerciale sino-américaine, le géant technologique Huawei, soupçonné d’espionnage par Washington, est dans le collimateur de plusieurs gouvernements occidentaux mais compte bien garder la confiance des pays africains où il est très implanté.
Considérée comme une entreprise suspecte par l’administration américaine, Huawei, connu pour ses téléphones mais qui fournit également des équipements de pointe pour les réseaux, pourrait en particulier perdre le droit de proposer le système Android de Google, équipant l’immense majorité des smartphones dans le monde.
L’Afrique subsaharienne, terrain privilégié des investissements chinois, peut-elle rester loyale à l’équipementier malgré ce coup d’arrêt?
A première vue, oui: preuve de sa confiance envers le géant de Shenzhen, l’Union africaine a signé fin mai un accord pour renforcer leur coopération technologique.
« C’est un moyen de montrer que Huawei est toujours présent en Afrique et qu’ils veulent y rester un acteur majeur en se positionnant sur ce secteur de croissance très important », observe pour l’AFP Ruben Nizard, économiste spécialiste de l’Afrique chez l’assureur Coface.
L’institution n’a pourtant pas été épargnée par les soupçons d’espionnage chinois: en 2018, le quotidien Le Monde avait affirmé que la Chine avait espionné le siège de l’UA, à Addis-Abeba.
Les informaticiens du bâtiment de la capitale éthiopienne avaient découvert que les contenus du serveur étaient envoyés la nuit à des milliers de kilomètres de là, vers Shanghai. Des accusations rejetées à Addis comme à Pékin.
Car depuis son arrivée en 1998 au Kenya, Huawei est très vite devenu un acteur incontournable en Afrique où il opère dans 40 pays. Il fournit aussi plus de la moitié du réseau 4G sur le continent.
Il va également développer des technologies 5G – la prochaine génération de téléphonie mobile, capable de transmettre beaucoup plus de données beaucoup plus rapidement – en Egypte, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations , du 21 juin au 19 juillet.
« Huawei a identifié le marché africain et l’a conquis grâce à une stratégie très agressive, basée sur des financements bon marché et une mise en oeuvre rapide. Le fait qu’ils équipent l’UA est révélateur », pointe Aly-Khan Satchu, analyste indépendant basé au Kenya, pour l’AFP.
La présence du groupe chinois déborde largement la vente de smartphones et la construciton de réseaux. Huawei propose aussi des équipements pour le transfert d’argent par mobile, très populaire notamment en Afrique de l’Est.
Tandis qu’en Afrique du Sud, le groupe chinois offre des formations aux étudiants dans les universités les plus réputées et a lancé cette année un programme de cours spécialisés sur la 5G.
L’investissement de Huawei va encore plus loin, avec le développement de technologies censées rendre les villes plus « intelligentes » et plus « sûres ».
En avril, le gouvernement kényan a par exemple signé avec Huawei un accord de 17,5 milliards de shillings (155 millions d’euros) pour la construction d’un centre de stockage des données informatiques et d’une « ville intelligente ».
Sur le site de l’équipementier, c’est le ministre de la Sécurité Nationale du Ghana, Albert Kan Dapaah qui n’hésite pas à vanter en personne les mérites du géant chinois en terme de vidéosurveillance.
« Quand un crime est commis, grâce aux caméras, on travaille de façon magique », assure-t-il, dans un clip promotionnel.
Le système de « Safe City » est déjà à l’oeuvre à l’Ile Maurice avec 4.000 caméras « intelligentes » sur 2.000 sites , ou dans la capitale kényane Nairobi.
« Cette solution peut empêcher les crimes à l’encontre des citoyens, touristes, étudiants, personnes âgées etc., avant qu’ils ne se produisent », assure Huawei, balayant les craintes d’une « dictature numérique » à la Big Brother émises par la presse mauricienne.
Huawei Marine participe d’ailleurs au déploiement du câble sous-marin PEACE long de 12.000 kilomètres qui relie actuellement le continent asiatique à l’Afrique, en partant du Pakistant pour aller jusqu’au Kenya et, à terme, jusqu’en Afrique du Sud.
Si Pékin semble avoir un coup d’avance sur le continent africain, la guerre commerciale pourrait rebattre les cartes en forçant les Etats à choisir entre Etats-Unis et Chine.
« L’Afrique est prise au milieu de cette guerre commerciale alors qu’ils ne devraient pas avoir à prendre partie car ils n’ont rien à y gagner », note Ruben Nizard.
« La donne est complètement nouvelle et nous aurons besoin d’un vrai leadership africain » sur ce sujet, souligne John Stramlau, professeur en relations internationales à l’université sud-africaine du Wits.